Le 14 septembre 1843, Mussolini, libéré de la prison du Gran Sasso, où il était détenu depuis son renversement par le Grand Conseil du fascisme, par les parachutistes du 1er bataillon du 7e régiment des Fallschirmjäger et les membres de l’unité spéciale des commandos de la Waffen-SS, Friedenthal, sous le commandement de l’Hauptsturmführer Otto Skorzeny, arrive par avion au quartier-général du Führer en Prusse-Orientale. Il y retrouve une poignée de compatriotes fidèles, qui, à leur arrivée à la Wolfsschanze cinq jours plus tôt, avaient annoncé à la radio, à la demande de Hitler, la constitution d’un gouvernement italien loyal à l’Axe. Parmi eux se trouvait un homme dont les relations houleuses qu’il avait depuis le milieu des années 1930 avec un certain nombre de plénipotentiaires et de services nationaux-socialistes ne laissaient pas présager la présence : Julius Evola.
De son activité dans les pays germaniques dans les années 1930 Evola ne dit rien ni dans la défense qu’il présenta lors de son procès aux assises de Rome dans la première semaine d’octobre 1951 ni dans son « autobiographie », « Le Chemin du Cinabre ». Tout juste apprend-on que le projet de revue bilingue italo-allemande dont il avait fait part à Mussolini (en 1941) fut « suspendu » (en 1942). « Le cours de la guerre, indique Evola, ne laisserait bientôt plus de place à de telles initiatives ». Dans un ouvrage richement documenté (« Mussolini and the Jews: German-Italian Relations and the Jewish Question in Italy », 1922-1945, 1978), l’historien israélien Meir Michaelis (1905 – 2005) dévoile les véritables raisons de l’annulation du projet, en décrivant par le menu les négociations serrées à ce sujet entre l’auteur italien et différents services nationaux-socialistes concernés au printemps 1942 à Berlin. Mais il a fallu attendre la publication en 1986 de « Julius Evola nei documenti segreti del Terzo Reich », qui comprend des extraits du dossier « Evola » déposé aux Archives Politiques du ministère des Affaires Étrangères à Bonn, pour pouvoir se faire une idée précise de ses rapports avec la hiérarchie nationale-socialiste et la position de celle-ci sur ses activités en Allemagne. À la fin des années 1990, « Julius Evola nei documenti segreti dell’Ahnenerbe » (Rome, 1997) et « Julius Evola nei rapporti delle SS » (Rome, 2000), nous ont permis d’en savoir plus à cet égard, tandis que la monographie de Thomas Hakl « Julius Evola und die deutsche Konservative Revolution » (1998) traitait pour la première fois une question connexe : les rapports concrets d’Evola avec les représentants de la « révolution conservatrice », fondement du « front traditionnel » qu’il projetait de bâtir. En 2015, un article de Nunziante Albano intitulé « Quando Evola passeggiava col Kronprinz. Un’indagine sui primi e misconosciuti rapporti con gli ambienti monarchici e neoconservatori tedeschi » souleva une autre partie du voile qui entourait encore cette question. Entre-temps, « Racial Theories in Fascist Italy » (2003) de l’historien Aaron Gillette et, dans une moindre mesure, « Julius Evola e la tentazione razzista » (2006) de Lloyd Thomas Dana avaient chacun apporté une contribution à une meilleure connaissance de l’attitude des responsables allemands en matière de politique raciale à l’égard des initiatives théoriques et pratiques d’Evola pour établir l’Axe sur un fondement racial.
L’une d’elles, appuyée par Mussolini, fut la publication, entre l’été 1942 et le premier trimestre de 1943, de la version allemande de « Sintesi di dottrina della razza », sous le titre, là aussi sanctionné par le Duce, de « Grundrisse der faschistischen Rassenlehre ». En raison des nombreuses suppressions, additions et variations, il est plus correct de parler de « version » que de « traduction ».
Si « Grundrisse » se traduit littéralement par « fondements », « abrégé » ou « éléments », aucun de ces termes n’a été retenu pour traduire ce titre en français. Il n’aura pas échappé au lecteur que le titre du premier livre d’Evola sur la race, à savoir « Il Mito del sangue » (« Le Mythe du sang ») (1937) renvoyait à celui de l’ouvrage majeur d’un idéologue dont la théorie raciale incarnait à ses yeux le racisme national-socialiste tout entier, auquel on sait que l’auteur italien ne ménagea pas ses critiques : « Der Mythus des 20. Jahrhunderts ». « Il Mito del sangue » est un ouvrage de commande, aussi est-ce peut-être l’éditeur (Hoepli) qui en choisit le titre. « Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie » a été traduit par « Introduction générale à la critique de l’économie politique » dans les « Œuvres » de Karl Marx dans la Bibliothèque de la Pléiade. Aussi avons-nous choisi comme titre français de « Grundrisse der faschistischen Rassenlehre » « Introduction générale à la doctrine fasciste de la race » (*).
Le texte est précédé d’une présentation d’une centaine de pages, à la fois descriptive et critique, des œuvres des auteurs de langue allemande qui eurent une influence sur la vision du monde d’Evola et des activités non seulement intellectuelles et culturelles, mais aussi paradiplomatiques, que le « baron » (**), comme l’avait surnommé le Sicherheitsdienst, mena en Allemagne du début des années 1930 à 1943. Nourrie de toutes les sources, primaires et secondaires, italiennes, allemandes, espagnoles et anglaises, disponibles à ce jour sur le sujet, elle livre des informations biographiques sur Evola qui étaient jusqu’ici inédites en langue française. Elle comprend aussi une analyse critique des trois principales critiques d’Evola à l’égard du national-socialisme, fondée sur la confrontation des affirmations de l’auteur italien aux écrits et aux déclarations des accusés. Sont ainsi examinés, entre autres, en étoffant les remarques déjà faites dans l’Appendice 1 de « Synthesis of the Doctrine of Race » (« On National-Socialist Racism »), lui-même version augmentée d’« Aperçu sur le racisme national-socialiste » (https://elementsdeducationraciale.wordpress.com/2015/12/02/apercu-sur-le-racisme-national-socialisme/), son réquisitoire contre le racisme national-socialiste et le reproche qu’il faisait à certains milieux nationaux-socialistes de tomber dans le « néo-paganisme » et aux autorités et aux théoriciens de la race allemands de ne pas donner une définition précise du terme d’ « Aryen ». Enfin, la question de la « deuxième naissance », considérée par Evola comme un préalable à la pleine jouissance de la qualité d’Aryen dans l’Inde primitive, est soumise à un nouvel examen à la lumière de sources beaucoup plus variées et de plus grande valeur que celles dont il disposait.

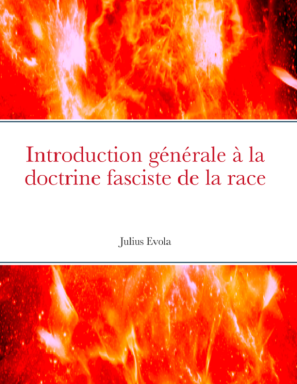
Les « premières expériences »
Les pays germaniques et les auteurs de langue allemande jouèrent un rôle majeur dans la vie et dans l’élaboration de l’œuvre d’Evola, depuis ses « premières expériences » jusqu’à sa maturité.
Des quatre penseurs qu’il cite dans son « autobiographie » comme ayant contribué à sa formation trois sont allemands : Friedrich Nietzsche, Max Stirner, Otto Weininger.
À l’époque où Evola commença à s’intéresser à la philosophie, « l’Italie était dominée par le néohégélianisme de Croce (1), puis, surtout, de Gentile (2). J’avais eu affaire à certains représentants de ce courant et j’étais irrité par leur présomption inouïe : simples intellectuels, ils se posaient en pontifes de la pensée critique et en hérauts de l’Esprit absolu et regardaient de haut, en les accusant de dilettantisme, des penseurs qui m’étaient chers et qui avaient dédaigné de donner à des intuitions et à des visions profondément vécues et d’une toute autre valeur une présentation systématique selon les règles de ce que Schopenhauer appelait “la philosophie pédagogique des professeurs de philosophie”. C’était en effet un monde de rhétorique boursoufflée. Ce qui me répugnait aussi, c’était que la théorie de l’Individu absolu, libre créateur du monde et de l’histoire, soit épousée par le type petit-bourgeois de l’enseignant salarié, marié et conformiste. Je n’ai pas besoin de dire que, pour ces personnes, les doctrines sapientielles que j’avais commencées à étudier en profondeur n’étaient que des “superstitions”, des résidus qui avaient été depuis longtemps dépassés par le déploiement de la “conscience critique” : ce point de vue leur était d’ailleurs naturel, puisque leur véritable substrat mental était malgré tout la “philosophie des Lumières” (3). »
Selon Evola, la « culture » occidentale dans son ensemble s’était engagée dans une voie sans issue, qui était « celle d’un savoir abstrait, éloigné de la vie et donc de moins en moins capable de répondre aux besoins individuels et au caractère concret de la vie (4) ». Il voulut donc « régler ses comptes (5) » et c’est à cette fin que, vers le milieu des années 1920 (6), il se mit à étudier systématiquement les classiques de la pensée idéaliste allemande, de Kant au « philosophe officiel de l’État prussien (7) » et, pour commencer, la plupart de ceux-ci n’ayant pas été traduits en italien, à apprendre la langue allemande. Il en sortit un système qu’il appela « Idéalisme magique » et une « Théorie de l’individu absolu ».
Pour Evola, « l’idéalisme, de Kant à Gentile, a posé le problème de la connaissance humaine d’une manière précise et insurpassable, mais n’a pas réussi à élaborer une doctrine de la praxis humaine aussi convaincante. Le sens d’une philosophie, dit Evola, de toute philosophie, n’est pas à chercher dans les constructions conceptuelles qu’elle produit, mais doit toujours être trouvé dans quelque chose de primordial, d’originel. En d’autres termes, toute philosophie naît d’une impulsion fondamentale de caractère irrationnel ou, pour mieux dire, d’une impulsion a-rationnelle, qui ne peut être ni déduite ni justifiée et par laquelle la raison est mise en mouvement. L’idéalisme, en tant que philosophie typiquement moderne et caractéristique de la civilisation occidentale, aurait pour motif originel une impulsion à l’affirmation, à la puissance, qui, dans l’histoire de la pensée occidentale, était d’ailleurs apparue bien avant l’idéalisme, avec Descartes et son exigence de certitude absolue. Le sens profond de l’idéalisme […] ne se trouve donc pas chez Hegel, Fichte ou Gentile, mais chez des auteurs comme Nietzsche, Stirner, Michelstaedter ou Weininger, chez qui l’exigence d’une pure affirmation individuelle est réaffirmée très clairement et sans ambiguïté (8) ». L’un des « […] problèmes spéculatifs liminaires propres à la pensée contemporaine » qu’Evola se mit en tête de résoudre afin de permettre « un élargissement essentiel des horizons (9) » fut celui du moi dans son aspect concret ; il s’y attaqua « sans tomber dans des conceptions matérialistes et en réaffirmant fortement le caractère de liberté absolue de ce moi (10) ».
Le moi evolien est libre de toute détermination logique et cognitive, dégagé des liens de la morale traditionnelle. Le bien, affirma Evola à la suite de Nietzsche, est ce que veut le moi. De fait, Nietzsche renforça ses dispositions par sa « révolte contre le monde bourgeois et sa morale mesquine, contre tout égalitarisme, démocratisme et conformisme et l’affirmation des principes d’une éthique aristocratique et des valeurs de l’être qui se libère de tout lien et se donne une loi à lui-même (11) ». En revanche, « la doctrine nietzschéenne du Surhomme dans ses aspects inférieurs – ceux, individualistes, esthétiques ou biologiques, qui sont relatifs à l’exaltation de la “vie” et auxquels, tant à cette époque que plus tard, beaucoup ont assimilé le message nietzschéen », n’eut « quasiment aucune influence » sur lui (12).
« Le moi evolien n’est lié à rien d’extérieur, ni à rien d’intérieur. Autrement dit, le moi ne possède pas de nature propre, d’essence, avec laquelle il serait obligé de composer. Pour Evola, il n’y a pas de nature antérieure qui s’imposerait au moi et le conditionnerait. Au contraire, c’est le moi qui crée sa propre nature, selon sa propre volonté (13) » : « une nature se réalise lorsqu’elle peut se développer sans rencontrer d’obstacles extérieurs, jusqu’à ce qu’elle atteigne son propre telos spécifique […]. La vraie liberté, pour Evola, est donc l’arbitraire absolu, sans contraintes ni présupposés et ne doit pas être confondue avec la liberté négative, qui consiste en l’absence d’empêchements extérieurs. Celle-ci n’est rien d’autre que spontanéité, détermination dynamique. Il s’agit d’une situation dans laquelle une possibilité de mouvement, de développement, est liée à une nécessité donnée (14) ». Or, selon Evola, ce concept négatif de liberté avait été adopté par la plupart des philosophes, d’Aristote et Spinoza à Leibniz et Hegel, en raison de leur incompréhension de ce qu’était réellement le « moi ».
Evola explique la nature du « moi » ainsi : « De même que le moi ne possède pas une nature morale déterminée, de sorte que, pour se réaliser, pour être libre, il devrait agir conformément à certaines valeurs, ainsi il ne possède pas une nature “rationnelle”. Dire le contraire reviendrait à présupposer une certaine idée de la rationalité et donc à se rabattre sur l’idée négative de la liberté, en vertu de laquelle le moi se trouverait dans un état de passivité à l’égard de quelque chose qui le transcende et sur lequel il n’a aucune prise. C’est, pour Evola, l’erreur que commettent les philosophies transcendantales. Elles présupposent à l’activité du moi les formes apriori de la sensibilité et les catégories de l’intellect, comme si celles-ci étaient quelque chose de primaire et d’indéductible. Mais, dit Evola, tout comme la nécessité dans la sphère empirique n’est pas soutenable […], il en va de même pour la nécessité dans la vie intérieure. Qui me dit, demande-t-il, que la nature de l’esprit humain est dialectique et qu’elle se développe nécessairement selon les étapes indiquées par Hegel dans sa Phénoménologie de l’Esprit ? Evola adresse à la “philosophie critique” les mêmes objections que celles qui ont été traditionnellement adressées au réalisme, mais sa critique concerne, non l’ordre empirique, mais l’ordre transcendantal. L’idéalisme gnoséologique est donc incapable de penser la liberté du moi jusqu’à la racine. La vraie liberté n’est que celle d’une causalité pure, d’une causa sui, c’est-à-dire d’une puissance contingente capable de déterminer sa propre essence, sa propre nature. Le moi pour Evola n’est pas rien, mais il peut tout faire, il est ce qu’il veut être. Evola, comme Stirner, veut donc “fonder sa cause sur rien” (15) ». Evola eut beau déclarer que « [l]’homme moderne doit apprendre ce moi qu’il ne sait encore que balbutier dans ces images déformées qu’en donne Stirner (16) […] », son Individu absolu n’en rappelle pas moins l’Unique (Der Einzige) du théoricien allemand de l’individualisme anarchiste (17) par certains côtés, notamment par l’affirmation que la réalisation de l’individu est fondée sur l’« égoïsme radical » du moi empirique et fini, détaché de toute codification morale, par l’antilibéralisme le plus radical et la révolte totale contre le dogme de l’égalité et le culte de l’humanité (18). Par contre, le rejet stirnerien de toute intégration politique et sociale de l’individu au motif que des entités telles que l’État, la société ou les classes sont de simples abstractions sans contenu réel n’éveilla aucun écho chez Evola.
Une fois circonscrite la liberté positive, il restait à Evola à traiter la relation entre la libre activité du moi et les formes qu’il se donne et qu’il donne au monde. « Il distingue deux types d’action : l’une selon le désir et l’autre selon l’autarcie. La première est celle de celui qui agit en fonction des impulsions et des appétits, qui s’imposent à lui comme s’ils venaient de “l’extérieur” et par rapport auxquels il est passif. En revanche, la seconde se réfère à une volonté véritablement absolue et qui n’est déterminée en rien, sauf par elle-même. Sur ce point, Evola se réfère une fois de plus à Michelstaedter qui avait décrit très bien la situation existentielle de ceux dont les actions sont motivées par la recherche du plaisir et celle de ceux qui sont capables d’agir d’une manière qui résulte de la “suffisance”. Selon le philosophe de Gorizia, le plaisir dépend de la satisfaction d’un besoin et donc de la cessation temporaire d’un état de manque. L’action qui recherche le plaisir, si elle parvient à faire cesser momentanément une privation, est cependant vouée à l’échec, car à la satisfaction d’un besoin succède immédiatement l’apparition d’un nouveau besoin, dans une soif inextinguible qui semble consubstantielle à la vie elle-même. Donc, l’action selon le désir, au lieu de nous libérer de nos déficiences, les confirme et les augmente, renforçant ainsi toujours plus notre dépendance aux “biens” extérieurs. Seul celui qui est suffisant, le “Persuadé”, qui, dans un état de centralité absolue, d’éternel présent, n’attend rien de l’avenir est tout simplement (19) ». Des idées similaires avaient déjà été exprimées non seulement par Nietzsche, mais aussi par Weininger, auquel Evola reprit l’idée d’un rapport entre le concept de principe masculin et l’idée d’un moi qui a son principe en lui-même (20). Plus tard, l’antisémitisme de Weininger, « fondé sur une vision du monde de type métaphysique et imprégné de sentiments antipositivistes », servit à Evola de « correctif idéal aux froides catégories physiologiques du Manifeste de la race (21) » et lui permit de racialiser les thèses de Bachofen. Plus tard encore, il fonda sa Metafisica del sesso sur les concepts weiningeriens d’inspiration platonicienne d’« homme absolu » et de « femme absolue (22) », dont il tira aussi une loi de l’attraction sexuelle.
Si l’intérêt d’Evola pour la philosophie naquit dès sa « prime adolescence (23) », son autobiographie atteste que c’est également à un très jeune âge qu’il prit conscience de et s’intéressa à la situation politique européenne. Sa première incursion sur ce terrain fit suite à « [l]a violente campagne (24) » en faveur de l’intervention de l’Italie qu’avaient menée au début de la Première Guerre mondiale les représentants de deux mouvements qui avaient d’abord suscité toute son attention : les futuristes et le groupe de Lacerba, revue de l’« iconoclaste » Giovanni Papini (25), auquel il manifesta de la reconnaissance pour avoir fait connaître en Italie « les courants étrangers les plus variés et les plus intéressants de la pensée et de l’art d’avant-garde et avoir ainsi provoqué un renouvellement et un élargissement des horizons », « le seul véritable Sturm und Drang que notre nation ait jamais connu (26) ». « Il était inconcevable pour moi, continue-t-il, que tous ces gens, l’iconoclaste Papini à leur tête, épousent avec légèreté les platitudes patriotiques les plus vicieuses de la propagande antiallemande, en croyant sérieusement qu’il s’agissait d’une guerre pour la défense de la civilisation et de la liberté contre le barbare et l’agresseur. Je n’avais pas encore quitté l’Italie ; je n’avais donc qu’un sentiment confus des structures hiérarchiques, féodales et traditionnelles, qui, si elles subsistaient en Europe centrale, avaient presque complètement disparu dans d’autres parties de l’Europe sous l’effet des idées de 1789. La direction de mes sympathies n’en était pas moins précise et, plus que l’abstention pacifiste et neutraliste de l’Italie, je souhaitais une intervention aux côtés de la Triple Alliance. Il est inutile de dire que, dans cette façon de voir, l’admiration académique pour la Kultur allemande – pour la pseudo-culture à la Herr Professor – n’était pour rien (27) ». Cette Kultur « informait au contraire le neutralisme de divers intellectuels bourgeois italiens (Benedetto Croce en tête), qui ne se rendaient pas compte que l’objet de leur admiration était quelque chose d’accessoire et d’insignifiant par rapport à la tradition la plus essentielle de ces peuples, qui devait être recherchée au contraire dans leur conception de l’État, dans les principes d’ordre et de discipline, dans l’éthique prussienne, dans les divisions sociales existantes, claires et saines, qui n’avaient été que partiellement altérées par la révolution du tiers état et par le capitalisme (28) ». Dans ce qui dut être un de ses tout premiers articles (29), qui dut être écrit peu avant ou peu après le 23 mai 1915 et dont il ne précise pas s’il fut publié, il soutint « que, du moment que l’on avait voulu faire la guerre à l’Allemagne au lieu de combattre à ses côtés, il aurait fallu le faire en adhérant aux principes allemands et non au nom du nationalisme et de l’irrédentisme ou des idéologies démocratiques, sentimentales et hypocrites de la propagande alliée (30) ».
Les « principes allemands » auxquels il adhéra inconditionnellement dès son adolescence étaient ceux des Gibelins et du Saint Empire romain germanique, « la dernière tentative en Europe de réalisation d’un système sacral, organique et hiérarchique fondé sur les principes transcendants de la Tradition (31) ». À l’époque, cependant, la « Tradition », pour Evola, était avant tout « méditerranéenne ». Dès 1927, dans un article paru dans Critica Fascista (32), il exhortait le fascisme à s’affirmer comme l’« Anti-Europe », c’est-à-dire « la résurrection de la tradition méditerranéenne archaïque, de cette tradition épique et magique, encore plus ancienne que l’aryenne, qui a tiré d’elle-même les civilisations égyptienne, chaldéenne, paléo-grecque et d’autres plus mystérieuses et lointaines, l’etteica, la sumérienne et l’étrusque, dont Mycènes et les Baléares portent les traces » et qu’il opposait à la « tradition sémitique importée du sol exotique de la Palestine », à savoir le christianisme. Ce fut précisément la thèse qu’il développa dans Imperialismo pagano (33) (1928). Il l’avait d’ailleurs reprise à Arturo Reghini (34) (1878 – 1946).
Le virage nordiciste
Evola fut amené à rectifier cette thèse en « [prenant] conscience de nouvelles lignes de pensée » « à l’époque du “Groupe d’Ur” (35) ».
Ces « nouvelles lignes de pensée » étaient celles qu’avaient tracées le juriste, philologue et sociologue suisse de langue allemande J. J. Bachofen (1815 – 1887), l’occultiste, historien et philologue néerlandais Herman Wirth (1860 – 1943), l’essayiste et futur théoricien du national-socialisme Alfred Rosenberg ainsi que, même s’il ne le nomme pas dans Il Cammino del cinabro, le paléontologue, géologue et philosophe naturel allemand Edgar Dacqué (1878 – 1945) (34). Il publia plusieurs comptes rendus critiques de leurs écrits dans Ur, puis dans Krur ainsi que dans les journaux italiens auxquels il collaborait (36).
D’Edgar Dacqué, « (l)’une des figures les plus importantes [du] cercle informel [d’Eugen Diederichs, éditeur, entre autres, de Wirth], très influente dans l’Allemagne wilhelmine et plus tard dans la culture conservatrice de la République de Weimar […] », il n’est pas exagéré de dire qu’il « aura un rôle important dans la formation doctrinale d’Evola (37) ». Considérant que l’approche évolutionniste de Lamarck et de Darwin était unilatérale, Dacqué s’efforça de la compléter en s’appuyant sur la morphologie idéaliste, la scienca intuitiva, de Goethe, méthode par laquelle le poète, dramaturge, scientifique et homme d’État allemand avait posé les premiers jalons de la morphologie comparative (38). Sa thèse fondamentale, exposée dans Urwelt, Sage und Menschheit (1924), est que « [l]e développement du règne de la vie est, du point de vue métaphysique et physique, la révélation de l’entéléchie de l’homme. Dans tout développement organique historique se trouve l’homme – fondamentalement et depuis le début (39) ». « L’homme était la lignée centrale, les autres espèces descendaient de lui » et n’en étaient que des formes plus ou moins dégénérées (40). Cet évolutionnisme à rebours rencontrait la doctrine des cycles cosmiques et l’idée connexe d’une « descente », d’une dégénérescence de l’humanité, qu’Evola avait trouvée chez René Guénon.
Dans Der Aufgang der Menscheit, Wirth (41) identifia l’Urwelt de Dacqué au continent de l’Atlantide ou terre d’Hyperborée, qu’il situait dans l’Atlantique Nord. Tout ce qu’il y avait de bon dans l’humanité, des lois et de la religion monothéiste au premier système d’écriture linéaire et à l’alphabet runique futhark, venait de leurs habitants : les Tuatha ; de race atlanto-nordique ou aryenne, ils étaient les plus anciens ancêtres des peuples germaniques. Ils vénéraient une trinité, dont la première personne était une déesse mère et ils rendaient un culte à des monuments mégalithiques. Lorsque la terre d’Hyperborée devint inhabitable il y a 10 000 ans en raison du déplacement des continents, les Tuatha se déplacèrent vers le sud et s’installèrent dans le Doggerland ou Polsete-Land, en mer du Nord. Leurs terres ayant été submergées au dernier millénaire avant notre ère, leurs descendants se répandirent sur le continent européen. Le Christ, comme l’avait soutenu Chamberlain avant Wirth, descendait d’une de ces tribus, qui, perdue, était arrivée en Palestine par bateau. Mais le christianisme fut infecté et corrompu par le despotisme et les superstitions orientales et perdit son lien avec la déesse mère. Les Tuatha se détournèrent de la nature et se mirent à vénérer les dieux de la guerre. Leur dieu devint un tyran, son fils une victime souffrante, la femme un objet de convoitise. La décadence régnait dans les villes, dont la santé des habitants déclinait en raison de la consommation d’alcool, de viande et de tabac ; la civilisation menaçait de périr. La civilisation occidentale moderne ne pourrait être sauvée que par le retour « au sol de la patrie et à la terre mère, à la source primitive de notre être, à l’expérience primitive de notre âme et à sa prise de conscience que sa spiritualité était voulue par Dieu (42) ». Selon Wirth, le national-socialisme était le seul régime politique capable d’opérer ce retour.
Outre le jugement très défavorable qu’il porta sur ces « tentatives de Wirth pour adapter ses reconstitutions préhistoriques à l’usage des tendances nationalistes et des slogans allemands qui sont actuellement en vogue » Evola jugea l’« arsenal philologique, anthropo-géologique, mythologique et symbologique » au moyen duquel il avait cherché à justifier les « intuitions extrascientifiques » sur lesquelles reposait sa théorie « extrêmement laborieux » et « d’une « solidité […] très relative (43) » et souligna que, «[a]lors que Wirth affirme que le symbole d’une prêtresse ou d’une mère divine aurait été prédominant chez les Nordico-Atlantiques […], Günther et d’autres le rapportent plus judicieusement aux races du sud et tout au plus aux Celtes, qui seraient une race déjà très éloignée de la pure race nordique et plus proche des races méditerranéennes (44) ». Donc, pas plus que Rosenberg avant lui, Evola n’accepta la thèse de Wirth que la société aryenne était matriarcale. Pour ces deux derniers, le patriarcat était propre à la race nordique, tandis que le matriarcat caractérisait les races du sud. Il n’en restait pas moins que « […] tout ce qui est scientifiquement inexact, arbitraire, fantaisiste et asystématique dans l’œuvre de Wirth ne doit pas dissimuler la force du “mythe” qui anime et dirige l’ensemble, son sens profond et son caractère de nécessité (45) […] ». Ce qu’en retint Evola fut l’effort de racialisation des mythes antiques (46) et l’attribution d’une origine nordique à la « Tradition », fondement de cette idéologie nordiciste (47) qui avait alors le vent en poupe en Allemagne. « Il est clair que la réadaptation des idées de Wirth par [Evola] et le désir [de celui-ci] d’en replacer les résultats les plus remarquables dans le contexte des doctrines traditionnelles constituent le point central qui différencie la Révolte contre le monde moderne […] de ses positions de jeunesse, exprimées dans de nombreux articles dans les années 1920 et dans son Impérialisme païen. Sans Der Aufgang der Menscheit, une grande partie de Révolte ne serait même pas concevable (48) ».
Une grande partie de l’œuvre de Wirth elle-même ne serait pas concevable sans Das Muterrecht. Inspiratrice, à la fin du XIXe siècle, d’auteurs tels que Friedrich Engels (49), August Bebel, Paul Lafargue et Heinrich Cunow, l’œuvre de Bachofen était plus ou moins tombée dans l’oubli, jusqu’à ce qu’elle soit redécouverte au début des années 1920 par des penseurs néoromantiques et néoconservateurs allemands opposés à l’émancipation de la femme tels que le philosophe et psychologue Ludwig Klages (1872 – 1956) et l’occultiste Alfred Schuler (1865 – 1923) et, dans la foulée, rééditée partiellement, notamment à l’initiative de membres du mouvement völkisch (50). Evola en publia trois extraits traduits dans La Torre (1er février – 15 juin 1930) (51), qu’il dirigeait. Il fut par là, deux décennies avant de réussir enfin à publier le recueil Le Madri e la virilità olimpica – Studi sulla storia segreta dell’antico mondo mediterraneo (1949), édité et préfacé par ses soins, le premier en Italie à essayer d’attirer l’attention sur Bachofen, comme il le souligna à juste titre dans Il Cammino.
Das Mutterrecht, histoire de la famille en tant qu’institution sociale, tente de démontrer, d’après l’étude des symboles, des mythes et des institutions de l’Antiquité, que le droit maternel a précédé historiquement le droit paternel, le matriarcat le patriarcat. La culture était passée par quatre phases : la condition primitive de l’homme, socialement, était ce que Bachofen appelle « hétaïrisme », condition dans laquelle le mariage n’existait pas ou, plus exactement, était communautaire. Au bout d’un certain temps, les femmes, choquées et scandalisées par un tel état de choses, se révoltèrent et établirent un système de mariage monogamique dans lequel le mari était soumis à la femme ; la filiation était matrilinéaire et la propriété et les honneurs se transmettaient exclusivement dans la ligne féminine ; l’avènement de cette société gynécocratique avait été déterminé par l’invention de l’agriculture ; la divinité la plus importante était la déesse de la fertilité Déméter ; le culte des divinités chthoniennes et lunaires prédominait sur celui des divinités célestes et solaires. « Dans ces rites, la femme joue le rôle actif et l’homme le rôle passif. La superstition primitive s’inclinait devant la science mystérieuse attribuée à la femme : la femme était dépositaire de l’inspiration divine et la transmettait aux hommes par l’initiation (52) ». Cette troisième phase prit fin lorsque Dionysos proclama que la paternité était supérieure à la maternité, que le père était le seul véritable parent, la mère n’étant qu’une nourrice. Mais les excès en tout genre auxquels donnaient lieu les cultes bachiques provoquèrent un retour à l’état de promiscuité de l’hétaïrisme, qui ne déplut pas aux femmes, jusqu’à ce qu’un choc en retour se produise et que la perception purement phallique que le dionysisme avait de la virilité soit sublimée et supplantée par une conception « immatérielle », « spirituelle », « apollinienne », « solaire » de la paternité : les pères occupaient désormais les premières places dans la famille et dans l’État ; les enfants portaient leur nom, la propriété et les droits de succession appartenaient à la ligne masculine.
De cette reconstitution d’une évolution historique en quatre étapes (hétaïrisme, matriarcat, dionysisme et apollinisme) marquée par la confrontation entre le principe masculin et spirituel d’une part et le principe féminin et matériel d’autre part Evola tira une morphologie des civilisations fondée sur un dualisme « entre la civilisation ouranico-virile et la civilisation féminine tellurique (ou lunaire) », entre « la civilisation des héros et la civilisation démétrienne (et, plus généralement, “gynécocratique”), entre les cultes olympiens solaires et les cultes chthonico-lunaires, entre le droit paternel et le droit maternel, entre l’éthique aristocratique de la différence et la promiscuité panthéiste et orgiastique (53) » ; cette morphologie des civilisations, il la développa « adéquatement » et systématiquement dans Rivolta contro il mondo moderno (1935) (54), en s’appuyant également sur Die Sage von Tanaquil: Eine Untersuchung über den Orientalismus (1870), dans lequel Bachofen applique sa méthodologie à la Rome antique.
Il s’agit d’une tentative de reconstitution allégorique des vicissitudes des relations conflictuelles entre les Romains et les Étrusques, caractérisés respectivement comme un peuple patriarcal et un peuple matriarcal et théocratique. Si leur opposition est considérée comme irréductible, les Étrusques sont cependant décrits comme « [l]es civilisateurs les plus importants pour l’Italie et surtout pour Rome (55) ». Pour Evola, aux yeux de qui ils n’étaient plus « les géniteurs de la lignée et de la tradition italiques » qu’il avait exalté en eux à l’époque où il avait écrit Imperialismo pagano, ils étaient au contraire les représentants d’une « culture tellurique et, tout au plus, lunaire-sacerdotale », radicalement opposée à la civilisation romaine ; leur religion « trahit l’esprit servile du sud (56) ». Avant lui, Rosenberg avait parlé de « lutte raciale » entre la civilisation romaine et la civilisation étrusque (57), affirmant même que les causes du déclin des patriciens romains résidaient d’une part dans le mélange avec les plébéiens – autorisation de mariage entre plébéiens et patriciens, accès des familles plébéiennes aux fonctions étatiques et sacerdotales -, d’autre part dans l’influence négative de la culture orientale étrusque, précurseur de l’Église (58). En 1932, Evola ne dit pas autre chose, lorsqu’il présenta la Rome antique comme une réaction nordique (59) contre un monde méditerranéen décadent et égalitaire, en faisant précisément référence à Der Mythus (60).
Des thèses de Bachofen il rejeta également celle du passage progressif de l’humanité antique d’un stade de promiscuité primordiale à la civilisation démétrienne de la Mère et de la Femme divine et, de celle-ci, à la civilisation héroïco-patriarcale liée aux cultes et aux mythes uraniques et héroïques : à la perspective évolutionniste et monogéniste du philologue suisse il substitua, peu ou prou comme Rosenberg (61), « une conception dynamique » et polygéniste, en faisant correspondre « les stades d’évolution présumés d’une seule souche humaine aux influences opposées produites par l’interaction de différentes souches (62) ». En revanche, il s’écartait de l’argumentation de Der Mythus sur tout ce qui s’y ressentait directement de l’idéologie de celui qu’Ernest Seillière appela à l’époque « le plus récent philosophe du pangermanisme mystique (63) » et dont Rosenberg était l’un des principaux propagateurs en Allemagne : l’essayiste et philosophe allemand d’origine britannique Houston Stewart Chamberlain (1855 – 1927), auteur de Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (1899).
B. Cariou, septembre 2021
(*) Introduction générale à la doctrine fasciste de la race est disponible à https://www.amazon.fr/dp/2954741619 et à https://store.pothi.com/book/julius-evola-introduction-g%C3%A9n%C3%A9rale-%C3%A0-la-doctrine-fasciste-de-la-race/.
(**) Voir, au sujet de ce titre nobiliaire, par lequel il acceptait de se faire appeler, https://www.academia.edu/43914122/Julius_Evola_Was_He_a_Baron_or_Not_English_.
(1) Benedetto Croce (1866 – 1952) était un philosophe, historien et critique littéraire italien dont l’œuvre eut une influence considérable, notamment dans les domaines de l’esthétique et de l’histoire. Il élabora son système philosophique dans la première décennie du siècle. Il s’agit d’un système d’orientation idéaliste en quatre volets, qu’il présenta dans trois livres publiés entre 1902 et 1909 : l’esthétique (Estética come scienza dell’espressione e linguistica generale), la logique (La logica come scienza del concetto puro), l’économie et l’éthique (Filosofia della pratica económica ed ética). En 1903, il fonda la revue La Critica, dont il se servit comme porte-voix de ses idées et à laquelle Giovanni Gentile collabora pendant quelques années. Nommé sénateur, il s’opposa d’abord à l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés de l’Entente, avant de voter en faveur de l’intervention lorsqu’il devint clair que le gouvernement italien avait fait ce choix. Avec l’arrivée au pouvoir de Mussolini, il démissionna de toutes les fonctions publiques qu’il occupait et prit la tête de l’antifascisme en 1925. À la fin de 1924, il rompit avec Gentile en raison de divergences politiques. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il collabora à la reconstruction du Parti libéral. Il se retira définitivement de la politique en 1948.
(2) Diplômé de la Faculté des Lettres et de Philosophie de l’École Normale de Pise en 1897, Giovanni Gentile (1875 – 1944) fut professeur d’histoire de la philosophie à Palerme (1906-1914), professeur de philosophie théorique à Pise jusqu’en 1919, professeur d’histoire de la philosophie à Rome à partir de 1917 et, toujours à Rome, professeur de philosophie théorique en 1926. Il développa une théorie qu’il appelait « idéalisme actuel » ou « actualisme » et qui se situait au carrefour de l’idéalisme transcendantal de Kant et de l’idéalisme absolu de Hegel. Selon lui, la philosophie idéaliste n’était pertinente que dans la mesure où elle pouvait être appliquée à la vie. Nommé ministre de l’Éducation à l’avènement du gouvernement fasciste (1922-1924), il entreprit une réforme radicale du système scolaire italien, que son successeur poursuivit dans les années suivantes. Titulaire de nombreuses fonctions culturelles (dont celle de président de l’Encyclopédie italienne) et politiques, il exerça une grande influence sur la culture italienne, surtout sur ses aspects administratifs. En 1943, il adhéra publiquement à la République de Salò. Il fut tué par des partisans antifascistes sur le pas de la porte de son domicile à Florence le 15 avril 1944.
(3) Julius Evola, Il Cammino del cinabro (1ère éd. numérique), Rome, Edizioni Mediterranee, 2014, p. 84. L’expression « illuminismo laico » est tautologique, puisqu’« illuminismo » veut dire « les Lumières » (Aufklärung) et que la philosophie des Lumières est une philosophe laïque. Du moins se présente-elle comme telle. En fait, comme on le sait, les « Lumières » servirent à recycler un certain nombre de vieilles antiennes sacerdotales, comme, par exemple, la notion d’égalité de tous les hommes entre eux, resucée sécularisée de l’idée chrétienne d’égalité de tous les hommes devant Dieu.
(4) G. F. Lami et G. De Turris (éd.), Evola e la politica. Evola tra poesia ed arte. Atti del Convegno Alatri, 2008, Edizioni Arktos, 2009, p. 10.
(5) Julius Evola, op. cit., p. 84.
(6) Dans son autobiographie, c’est juste après avoir parlé des difficultés qu’il rencontra à faire publier Teoria dell’Individuo Assoluto, dont on sait qu’il fut achevé en 1924 (Julius Evola, Teoria dell’Individuo Assoluto, 3e éd. corrigée, Rome, Edizioni Mediterranee, 2013, p. 7), qu’Evola indique s’être mis à l’étude systématique des grand classiques de l’idéalisme allemand. Il est donc légitime d’en conclure que peu de temps sépara ces deux entreprises.
(7) William F. Lawhead, Voyage of Discovery: A Historical Introduction to Philosophy, 4e éd., Stamford, CT, Cengage Learning, 2015, p. 404. La qualification de Hegel de « philosophe officiel de l’État prussien » est de Karl Popper (La société ouverte et ses ennemis, t. 2 : Hegel et Marx, Paris, Le Seuil, 1979 [1945] ; voir aussi Ernst Cassirer, Le Mythe de l’État, Paris, Gallimard, 1993 [1946]).
(8) G. F. Lami et G. De Turris, op. cit., pp. 10-11.
(9) Julius Evola, Il Cammino…, p. 79.
(10) G. F. Lami et G. De Turris, op. cit., p. 18.
(11) Julius Evola, op. cit., p. 36.
(12) Ibid.
(13) G. F. Lami et G. De Turris, op. cit., p. 19.
(14) Ibid.
(15) Ibid., pp. 19-20.
(16) Julius Evola, op. cit., p. 82.
(17) Influencé par Feuerbach, Bauer et, en général, par la « gauche hégélienne », Max Stirner (1806 – 1856) est considéré à la fois comme l’un des fondateurs de l’anarchisme radical et comme un précurseur de l’existentialisme. « L’œuvre majeure de Stirner est déconcertante tant par sa forme que par son contenu. Il remet en question les attentes quant à la manière de développer les arguments politiques et philosophiques et ébranle la confiance du lecteur dans la supériorité morale et politique de la civilisation contemporaine. Stirner lance une attaque en règle contre le monde moderne, de plus en plus dominé par des modes de pensée “religieux” et des institutions sociales oppressives, tout en esquissant une alternative “égoïste” radicale dans laquelle pourrait s’épanouir l’autonomie individuelle. Si l’impact historique de Der Einzige und sein Eigenthum est parfois difficile à évaluer, on peut dire avec certitude que l’œuvre de Stirner a eu un impact immédiat et destructeur sur le mouvement hégélien de gauche, qu’elle a joué un rôle important dans le développement intellectuel de Karl Marx (1818 – 1883) et qu’elle a ensuite influencé de manière significative la tradition politique de l’anarchisme individualiste » (David Leopold, « Max Stirner », The Stanford Encyclopedia of Philosophy [En Ligne], 2019, disponible à : https://plato.stanford.edu/entries/max-stirner. Voir aussi Sander L. Gilman et David J. Parent, Conversations with Nietzsche, A Life in the Words of his Contemporaries, New York/Oxford, Oxford University Press, 1987, p. 238. Nietzsche lui-même fut influencé par Stirner : « […] les affinités de pensée entre ce représentant unique d’un anarchisme individualiste (extrême) et l’individualisme de Nietzsche sont telles qu’il […] paraît légitime de soutenir la thèse d’une ressemblance (dans certaines limites) des deux systèmes de pensée – ressemblance qui s’établit notamment au niveau du refus radical de l’État, de la morale, du droit, de la pitié et de l’égalitarisme. Des différences de vue deviennent cependant transparentes à partir du moment où Stirner, au nom de l’unéitisme égoïste, appelle à la révolte antiautoritaire contre l’État, le droit et les institutions, alors que Nietzsche, en philosophant “avec le marteau”, se contente d’en appeler à la force et à la puissance de l’“homme supérieur” qui méprise les faibles et les malades, les pauvres, les prolétaires et les démocrates, au nom d’un “aristocratisme d’esprit”, de la nécessité d’un “pathos de la distance” et de la supériorité (physique et morale) des maîtres (seigneurs) sur les esclaves. Alors que la critique nietzschéenne de la morale est, au fond même, une critique du “nihilisme” chrétien, opposant à ce dernier une antimorale vitaliste, l’unicisme égoïste de Stirner débouche, de par sa volonté destructrice quasiment illimitée, sur une volonté “nihiliste” voulant faire table rase de tout ce qui ose s’opposer au Moi et à sa volonté de toute-puissance. Ce qui les unit cependant, c’est la volonté commune d’élaborer les fondements théoriques d’une doctrine radicalement consciencielle de l’individu, défendant sa propre dignité contre toutes les contraintes imposées par la collectivité et l’État, son représentant par excellence, dans la réalité sociale » (Arno Münster, « Le moi, l’unique et le néant : Nietzsche et Stirner. Enquête sur les motifs libertaires dans la pensée nietzschéenne », Revue germanique internationale, n° 11, 1999, pp. 157-172 ; voir aussi François Hatot, « Nietzsche avec Stirner – Éléments spinozistes de réponse à une question centenaire ». Mémoire de Master II, Université de Paris IV, décembre 2006 ; John Glassford, « Did Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) Plagiarise from Max Stirner (1806 – 56)? », Journal of Nietzsche Studies, n° 18, automne 1999, pp. 73-79 ; Thomas H. Brobjer, « A Possible Solution to the Stirner-Nietzsche Question », Journal of Nietzsche Studies, n° 25, été 2003, p. 109-114).
(18) Emanuele La Rosa, « Evola lettore di Stirner. Individualismo, egoismo, autarchia », Tracce, xxix, n° 32, 2010, pp. 120-130. Dans une thèse de doctorat en sociologie intitulée « I rapporti tra la Massoneria italiana e il Fascismo », Fabio Venzi (né en 1961), Grand Maître de la Grande Loge Régulière d’Italie depuis 2001, directeur de la revue maçonnique De Hominis Dignitate et auteur de nombreux livres sur le néoplatonisme, sur Joachim de Fiore, Raymond Lulle et la psychanalyse, caractérise la philosophie d’Evola comme une tentative de synthèse de l’individualisme absolu de Hegel, du nihilisme de Nietzsche et de l’anarchisme égoïste et solipsiste de Stirner. De très courts extraits de cette thèse a priori intéressante sont cités par don Curzio Nitogla, « Evola Massone? », doncurzionitoglia.wordpress.com, 27 juillet 2015, disponible à : https://doncurzionitoglia.wordpress.com/2015/07/27/evola-massone. Venzi a également publié Julius Evola e la libera Miratoria. Una verità scomoda (Rome, Settimo Sigilio, 2010), présenté par l’éditeur comme « une contribution importante à la connaissance des relations orageuses qu’Evola a entretenues avec la franc-maçonnerie – et avec les francs-maçons ».
(19) G. F. Lami et G. De Turris, op. cit., p. 22.
(20) Ibid., p. 22, note 48.
(21) Alberto Cavaglion, Otto Weininger in Italia, Carucci, 1982, p. 118. Evola n’alla pas jusqu’à reprendre l’analogie qu’avait établie Weininger entre l’homme véritable et la race aryenne d’une part et la femme véritable et la race sémitique d’autre part, analogie qu’il imputa au « caractère misogyne, puritain et sexophobe de [l]a curieuse équation personnelle » (Julius Evola, Il Cammino…, p. 328) du philosophe autrichien. En revanche, il est clair qu’il adhéra à « l’idée [de Weininger] » que, « du point de vue d’une conception normale et différenciée des sexes, la femme et l’homme se présentent à peu près comme l’expression de deux “races” différentes, sinon opposées » ; même si l’incise (« Resta valida, nelle sue vedute che […] » : « […] selon lui, l’idée reste valable que […] ») qui précède immédiatement cette proposition semble exprimer une restriction à cette idée, la section où elle se trouve s’intitule « La race masculine et la race féminine ».
(22) Les concepts weiningeriens d’« homme absolu » et de « femme absolue » ne pouvaient que renforcer la conviction d’Evola que « […] la différence physique doit être conçue comme la correspondance d’une différence spirituelle ; ainsi, on n’est homme ou femme physiquement que parce qu’on l’est transcendantalement et le sexe, loin d’être une chose sans importance relativement à l’esprit, est signe d’une voie, d’un dharma distinct » (Rivolta contro il mondo moderno, 3e éd., revue, Rome, Edizioni Mediterranee, 1969, p. 210) : non seulement le sexe est d’abord et avant tout dans l’esprit, mais la race l’est aussi. De plus, l’idée de Weininger que, entre l’homme absolu et la femme absolue, il existe des « formes sexuelles intermédiaires » (Otto Weininger, Sexe et caractère, traduit de l’allemand par Daniel Renaud, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1975, p. 38, 66), complétait l’idée de Bachofen que, « entre les deux pôles [le patriarcat et le matriarcat], il existait diverses formes intermédiaires ou mixtes » (Julius Evola, Il Cammino…, p. 159) ; Evola se servit de la première pour renforcer la seconde dans sa typologie des civilisations.
(23) Julius Evola, op. cit., p. 78.
(24) Ibid., p. 39.
(25) Giovanni Papini (1881 – 1956) était un poète et un écrivain italien qui se rendit célèbre par son engagement dans le mouvement artistique moderniste et son athéisme. Il fit scandale en suggérant que Jésus avait eu une relation homosexuelle avec l’apôtre Jean. Après la Première Guerre mondiale, il revint au catholicisme et devint un éminent intellectuel fasciste.
(26) Julius Evola, op. cit., p. 37.
(27) Ibid., p. 39.
(28) Ibid.
(29) Entre 1916 et 1922, Evola publia de nombreux poèmes, dont le plus connu aujourd’hui est La parole obscure du paysage intérieur, poème à 4 voix (Zurich, 1920, « Collection Dada » [tirage limité à 99 exemplaires], traduit de l’italien par l’auteur et Maria de Naglowska), dans divers recueils et revues, dont Bleu (1920-1921), qu’il avait cofondé et qui lui permit de se faire connaître de Tristan Tzara. Son activité journalistique ne débuta qu’en 1924, où il commença à collaborer à la revue de Reghini Atanòr (1924-1925), à laquelle succéda Ignis (1925-1929), dont il fut l’un des premiers collaborateurs (voir Gianfranco De Turris, « La Cultura sotterranea [I Parte] », Civiltà, n° 8-9, septembre-décembre 1974 ; Marco Rossi, « Julius Evola e la Lega teosofica indipendente di Roma », Storia Contemporanea, XXV, n° 1, février 1994, pp. 39-55 ; Luca Lo Bianco, « Evola Giulio Cesare Andrea [Julius)] », in Fabrizi Nicola [dir.], Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 43, Rome, 1993, p. 575).
(30) Julius Evola, op. cit., p. 39.
(31) Franco Ferraresi, « Julius Evola: Tradition, Reaction, and the Radical Right », European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie/Europäisches Archiv für Soziologie, vol. 28, n° 1, Über politisches Handeln, 1987, pp. 107-151.
(32) Julius Evola, « Fascismo antifilosofico e tradizione mediterranea », Critica Fascista, V, 12, 15 juin 1927 [pp. 227-229], p. 227.
(33) Voir, au sujet de la « tradition méditerranéenne » dans Imperialismo Pagano, Andrea Avalli, La questione etrusca nell’Italia fascista. Thèse de doctorat, Université de Genève, 2020, p. 310.
(34) Mathématicien, philosophe et occultiste, Arturo Reghini, diplômé en mathématiques à l’université de Pise, enseigna cette matière dans plusieurs lycées de Toscane, de Rome et d’Émilie-Romagne. En 1898, il rejoignit la Société théosophique et en fonda une section à Rome. En 1903, il créa la Bibliothèque théosophique de Palerme. Il fut initié au Rite de Memphis dans cette ville et plus tard, à Florence, il institua la loge « Lucifero », sous l’autorité du Grand Orient d’Italie. Il est reconnu comme l’un des « pères spirituels » du Rite Symbolique Italien, établi au sein du Grand Orient d’Italie. Il fonda plusieurs revues, dans lesquelles il exprima ses idées : Leonardo (1906), Atanòr (1924-1925) et Ignis (1925-1929) ainsi que, avec Julius Evola et Giulio Parise, Ur (1927-1928). Il eut droit à la reconnaissance publique de l’Accademia dei Lincei et de l’Accademia d’Italia pour ses travaux sur la géométrie pythagoricienne.
(35) Julius Evola, Il Cammino…, p. 156.
(36) Arvo, « Ricerche moderne sulla tradizione nordico-atlantica », Ur, II, n° 11-12, novembre-décembre 1928, pp. 357-366, repris in id., I Testi di Ordine Nuovo, Edizioni di Ar, Padoue, 2001, pp. 62-68 ; id., « L’Aurora dell’Occidente », Krur, I, n° 3-4, février-mars 1929 ; id., « La tradizione nordico-atlantica. Agli albori dell’umanità », Il Tevere, 13-14 avril 1929, p. 3 ; id., « Il ritorno alle origini. Atteggiamenti della Germania contemporanea », Il Tevere, 24 juillet 1929, p. 3 ; id., « Aspetti del movimento culturale della Germania contemporanea », Nuova Antologia, vol. 269, janvier-février 1930, pp. 83-97, repris in id., I saggi della Nuova Antologia, Padoue, 1982, pp. 18-24.
(37) Nunziante Albano, « Quando Evola passeggiava col Kronprinz. Un’indagine sui primi e misconosciuti rapporti con gli ambienti monarchici e neoconservatori tedeschi », Vie della Tradizione, XLVI, vol. XLVIII, n° 168-169, janvier-décembre 2015, p. 6. « Dacqué renverse plus ou moins la thèse darwinienne. Il conteste résolument que l’homme provienne d’autre chose que de l’homme lui-même. Quant aux autres espèces, ce serait plutôt le contraire de ce que suppose l’évolutionnisme : au lieu que l’homme soit un animal évolué, les animaux – du moins ceux qui sont les plus proches de l’homme et en premier lieu le singe – seraient les branches dégénérées d’une souche qui devrait être considérée, dès les origines, comme humaine. Bien entendu, cette thèse ne doit pas être prise de manière simpliste. Par “homme” Dacqué entend ici une “puissance” ou “entéléchie”, qui, au cours des époques biologiques, selon les diverses conditions du milieu, se serait manifestée sous des formes variées. Celle de l’homme actuel que nous connaissons serait la dernière, la plus récente d’entre elles. Chaque époque géologique a ses propres caractéristiques. Les espèces vivantes les adoptent ; elles se différencient et se créent des structures et des organes donnés. Mais chacune reste elle-même : les analogies morphologiques sont toutes externes et ne doivent pas être interprétées comme des filiations et des descendances génétiques » (Julius Evola, « La scimmia deriva dall’uomo? », La Stampa, 14 juin 1943, repris in id., I Testi de La Stampa, Edizioni di Ar, Padoue, 2004, p. 62). Gotffried Benn lui-même fut très impressionné par la thèse de Dacqué (voir Martina Kolb, Nietzsche, Freud, Benn, and the Azure Spell of Liguria, Toronto/Buffalo/Londres, University of Toronto Press, 2013, p. 223, note 96).
(38) Hendrik C. D. de Wit, Histoire du développement de la biologie, vol. 2, traduction et adaptation française par Hendrik C. D. de Wit et A. Baudière, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 1993, pp. 400-408 ; Éléonore Faivre d’Arcier, « L’imagination créatrice entre forme et liberté. Goethe, Kant, Cassirer », in id., Jean-Pol Madou et Laurent Van Eynde (éd.), Mythe et création. Théories, figures, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2019, pp. 49-67.
(39) Cité in Werner Quenstedt, « Manfred Schröter: Dacqué Edgar Viktor August », Neue Deutsche Biographie [En ligne], 3, 1957, pp. 465-467.
(40) Sabine Doering-Manteuffel, L’occulte. L’histoire d’un succès à l’ombre des Lumières. De Gutenberg au World Wide Web, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 2019, p. 177.
(41) Les livres de Wirth, en particulier Der Aufgang der Menschheit (1928), eurent une profonde influence sur la culture populaire du IIIe Reich. Les romans pseudo-historiques à succès d’Edmund Kiss (1886 – 1960) s’en inspiraient en grande partie, tout comme les magazines de science-fiction très populaires de Lok Myler (1901 – 1970) (Manfred Nagl, Science Fiction in Deutschland: Untersuchungen zur Genese, Soziographie und Ideologie der phantastischen Massenliteratur, Tubingue, Tübinger Vereinigung für Volkskunde, 1972, p. 179, 180, 183 ; id., « SF, Occult Sciences, and Nazi Myths », Science Fiction Studies, vol. 1, n° 3, 1974, pp. 185-197 ; Hans Wolfgang Behm, « postface », in Edmund Kiss, Die letzte Königin von Atlantis. Ein Roman aus der Zeit um 12000 vor Christi Geburt, Leipzig, 1931 [pp. 203-234], p. 210, 228).
(42) Cité in Cynthia Eller, « Matriarchy and the Volk », Journal of the American Academy of Religion, vol. 81, n° 1, mars 2013 [pp. 188-221], p. 206 ; voir aussi Joscelyn Godwin, Atlantis and the Cycles of Time: Prophecies, Traditions, and Occult Revelations, chap. 5 : « Germanic Atlantology », Rochester, VT/Toronto, Inner Traditions, 2010, pp. 132-141.
(43) Julius Evola, Il Mito del sangue, 2e éd., revue et augmentée, 1942 [Borzano, SeaR Edizioni, 1995, pp. 161-162].
(44) Ibid., pp. 180-181.
(45) Ibid., p. 162.
(46) Voir Aaron Gillette, Racial Theories in Fascist Italy, Londres/New York, Routledge, 2002, p. 156. Voir, au sujet de la racialisation de la morphologie des civilisations de Bachofen par Wirth, Jennifer Meyer, « La racialisation de l’ordre des sexes dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres. Trois cas d’antisémitisme genré », in GenERe [éd.], Épistémologies du genre. Croisements des disciplines, intersections des rapports de domination, ENS Éditions, 2018, pp. 215-228 ; Marie-Laurence Haack, « Tanaquil et les chemises noires et brunes », Anabases, n° 24, 2016, pp. 93-116 ; id., « Les Étrusques dans l’idéologie national-socialiste. À propos du Mythe du xxe siècle d’Alfred Rosenberg », Revue historique, janvier 2015, n° 673, pp. 149-170.
(47) Le nordicisme trouve son origine dans les écrits d’Arthur de Gobineau (1816 – 1882), le premier à prétendre prouver la supériorité de la « race nordique ». L’idéologie nordiciste fut officiellement approuvée par le NSDAP, dans la formulation que lui donna H. F. K. Günther, en 1933 (voir Johann Chapoutot, Le National-socialisme et l’Antiquité, Paris, PUF, 2008, pp. 25 et sqq.).
(48) A. Branwen, Ultima Thule. Julius Evola e Herman Wirth, Parme, Edizioni All’insegna del Veltro, 2007, p. 67.
(49) En fait, la tentative d’Engels de reconstitution du matriarcat préhistorique s’appuie sur le livre de l’anthropologue états-unien Lewis Henry Morgan Ancient Society (1878) plus que sur Das Mutterrecht, que, dans L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884), le philosophe allemand critiqua vigoureusement pour avoir fait de la religion « le levier de l’histoire du monde », cité in Cynthia Eller, op. cit., p. 92.
(50) Dès 1924, Carl Albrecht Bernoulli avait publié J. J. Bachofen und das Natursymbol (Bâle) (voir Jost Hermand, « All Power to the Women: Nazi Concepts of Matriarchy », Journal of Contemporary History, vol. 19, n° 4, octobre 1984, pp. 649-667). Deux ans plus tard, Alfred Bäumler donna une introduction intitulée « Bachofen, der Mythologe der Romantik » (1926) à Der Mythus von Orient und Occident: Eine Metaphysik der alten Welt (Munich, 1926, pp. xxv-ccxiv), recueil de textes de Bachofen édité par l’expert allemand d’Oswald Spengler Manfred Schrötter (1880 – 1973). L’année suivante, le dramaturge, écrivain et essayiste allemand Werner Deubel (1894 – 1949), collaborateur du Völkische Kultur et ami proche de Ludwig Klages (Reinhard Falter, Ludwig Klages. Philosophy of life as a critique of civilization. Munich, Telesma-Verlag, 2003, p. 68), publia un article intitulé « Der Kampf um Johann Jakob Bachofen » dans le Preussische Jahrbücher (n° 209, 1927, pp. 66-75) et, deux ans plus tard, l’historien de l’art suisse Georg Schmidt (1896 – 1965) fit paraître Johann Jakob Bachofens Geschichtsphilosophie (Munich, 1929), thèse de doctorat soutenue peu avant à l’université de Bâle.
(51) Julius Evola, « Il simbolo », La Torre, n° 7, pp. 221 et sqq., extrait traduit d’Urreligion und antike Symbole (Leipzig, 1926, vol. 1, pp. 283-284) ; id., « La donna regale e la nascita di Roma », La Torre, n° 9, pp. 341 et sqq., extrait traduit (par Otto Lanz) de Die Sage von Tanaquil (Heidelberg, 1870) et id., « La missione occidentale di Roma », La Torre, n° 10, pp. 376 et sqq., suite de l’article précédent (voir Stefano Arcella [éd.], Lettere di Julius Evola a Benedetto Croce (1925-1933), Rome, Fondazione Julius Evola, 1995, p. 30).
(52) Gustave Fougères, Mantinée et l’Arcadie, A. Fontemoing, 1898, p. 325.
(53) Julius Evola, Il Cammino…, p. 159.
(54) Ibid., p. 162.
(55) Cité in Marie-Laurence Haack, « Tanaquil… ».
(56) Julius Evola, « Il simbolo aristocratico romano e la disfatta classica dell’Aventino », La Nobiltà della Stirpe, II, 11-12, novembre-décembre 1932, pp. 345-359, repris in id., La Nobiltà della Stirpe [p. 84-97], p. 86, 87, 88-89.
(57) Voir Miller Martin, « Alfred Rosenberg, die Etrusker und die Romfrage », in Marie-Laurence Haack et id. (dir.), Les Étrusques au temps du fascisme et du nazisme, Pressac, Ausonius Éditions, 2016, pp. 81-94.
(58) Cité in Andrea Avalli, op. cit., pp. 310 et sqq. Rosenberg reprit la thèse de l’origine étrusque de l’Église catholique et de la sorcellerie à l’indianiste et tibétologue allemand Albert Grünwedel (1856 – 1935) qui l’avait exposée dans Tusca (1922) et avait ensuite tenté, en collaboration avec l’occultiste Otto Ilzhöfer, d’établir des liens entre les Étrusques et les Juifs. Il semblerait qu’Evola ait pris connaissance de cette thèse non pas directement par Grünwedel, qu’il cite néanmoins, mais par Rosenberg (ibid., p. 321, 322, 339).
(59) Arnaud Guyot-Jeannin (Julius Evola, Lausanne, Éditions l’Âge d’Homme, 1997, p. 147) affirme que ce fut chez Rosenberg qu’Evola trouva l’idée que les premiers Romains étaient d’origine nordique. Or, cette idée avait déjà été énoncée par Wirth et par l’archéologue et historien français André Piganiol (1883 – 1968), dont l’Essai sur les origines de Rome (Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, fasc. CX, Paris, E. de Boccard, 1917) est précisément cité à cet égard dans Rivolta (p. 318, note 25). Adversaire déclaré de la théorie de la « romanité nordique », que défendirent également entre autres H. F. K. Günther dans Rassenkunde des deutschen Volkes (Munich, J. F. Lehmann, 1922) et le théoricien de la race suédois Herman Lundborg (Rassenkunde des Schwedischen Volkes, 1928) (Merle Wessel, « The Concept of the “Nordic Race” in German and Nordic Racial-Theoretical Research in the 1920s », Nordeuropaforum-Zeitschrift für Kulturstudien, 2016 [pp. 29-49], p. 33), Guyot-Jeannin (op. cit., p. 148) s’imagine l’avoir démolie par le biais des « donnée(s) très décisive(s) et sans équivoque » que fournit « le témoignage très autorisé [apporté dans BG, II.30.4] […] en ce qui concerne l’ethnie romaine du temps de César ». Outre que le « multiculturalisme » que favorisait César ne fut peut-être pas pour rien dans l’apparence peu nordique de ses troupes (Ethan Malveaux, The Color Line: A History: The Story of Europe and the African, from the Old World to the New, Bloomington, IN, Xlibris, 2015, p. 27), comment peut-on sérieusement penser déduire de l’apparence physique des Romains du temps de César le type romain originel ?
(60) Julius Evola, « Il simbolo aristocratico romano e la disfatta classica dell’Aventino », La Nobiltà della Stirpe, II, 11-12, novembre-décembre 1932, pp. 345-359, repris in id., La Nobiltà della Stirpe (1932-1938), Rome, Fondazione Julius Evola, 2002, pp. 84-97. Dans « Il mito della nascita di Roma » (Il Popolo di Roma, 21 avril 1934), Evola caractérisa pareillement « le développement de Rome […] comme la victoire de l’esprit héroïque indo-européen » sur « la composante lunaire-sacerdotale et, ethniquement, étrusco-sabine » ; voir id., « Roma contro Tuscia », Il Corriere Padano, XVI, 27 novembre 1938, repris in id., I Testi del Corriere Padano [p 340-2] ; id., « Roma contro Tuscia », Il Regime Fascista, X, 15 mars 1935 ; id., « Panorama razziale dell’Italia preromana », La Difesa della Razza, IV, 16, 20 juin 1941, repris in id., I Testi de La Difesa della Razza, pp. 177-181.
(61) « Même si Rosenberg, intéressé par la question religieuse, la question sexuelle et la préhistoire, était imprégné des travaux de Bachofen et reconnaissait l’existence de sociétés matriarcales dans le passé, il considérait que le matriarcat et le culte des déesses n’étaient ni un passé bienheureux ni un avenir désirable. Le matriarcat préhistorique, selon Rosenberg, détournait l’attention de la progression historique plus importante de la Rassenseele, l’âme de la race […]. Comme d’autres admirateurs fascistes de Bachofen avant lui, Rosenberg nia être véritablement en conflit avec Bachofen. Il affirmait plutôt que Bachofen avait été mal interprété par “de nombreux penseurs malades” qui confondaient les “fantasmes excessifs, bien qu’occasionnellement intéressants, de Bachofen sur le droit maternel” avec la “vérité historique”. Rosenberg en conclut que Bachofen ne s’était pas vraiment compris lui-même et n’avait donc pas réussi à tirer la conclusion évidente qu’une race supérieure – à savoir les Aryens – était responsable de l’apparition du patriarcat » (Cynthia Eller, op. cit., pp. 198-199, 202). Deux de ces « nombreux penseurs malades » étaient H. Wirth et le philosophe allemand Ernst Bergmann (1881 – 1945). Les thèses du premier avaient été attaquées dans Der Mythus (p. 115, 669), mais ce furent les partisans de l’idéologue national-socialiste qui leur portèrent le coup de grâce. En 1934, Wirth avait réédité l’Ura-Linda-Chronik – dont il avait été démontré peu après sa publication en 1872 que c’était un faux –, dans le but de démontrer que l’« Urvolk » germanique était organisé selon des principes matriarcaux. Il s’en était suivi dans le mouvement “völkisch” un débat sur le matriarcat et le patriarcat, sur la masculinité et la féminité, ainsi que sur le rôle des femmes dans la construction du IIIe Reich. « Wirth, le 4 mai 1934 à Berlin, subit une humiliation publique lors d’un débat sur la Chronik, au cours duquel des historiens et des philologues, vivement soutenus par Alfred Rosenberg, mirent en pièces ses travaux et le couvrirent de ridicule. Le Völkischer Beobachter rapporta que l’événement avait marqué un triomphe sur une idée nuisible qui menaçait de saper le mouvement et [le philologue] Arthur Hübner taxa Wirth d’“eine offentliche Gefahr für Deutschland […] demokratisch, fuhrerfeindlich, pazifistisch”. D’anciens partisans [de Wirth] […] commencèrent alors à prendre leurs distances avec lui, sentant sans doute de quel côté le vent politique soufflait […]. Dès lors, il devint clair que la théorie du matriarcat était incompatible avec une carrière universitaire sous le national-socialisme » (voir Peter Davies, « ‘Männerbund’ and ‘Mutterrecht’: Herman Wirth, Sophie Rogge-Börner and the Ura-Linda-Chronik », German Life and Letters, vol. 60, n° 1, janvier 2007 [pp. 88-115], p. 108 ; id., Myth, Matriarchy and Modernity: Johann Jakob Bachofen in German Culture. 1860-1945, chap. 9 : « Feminine Myth and Masculine Politics: National Socialism and Matriarchy », Berlin/New York, Walter de Gruyter, 2010). Quant à Bergmann, lorsque, dans Sintesi di dottrina della razza (Padoue, Edizioni di Ar, 1978 [Hoepli, 1941], p. 204, note 1), Evola le critiqua à juste titre pour s’être « donné pour mission de formuler l’évangile d’une nouvelle “Église nationale allemande”, tout en soutenant, dans l’ouvrage Muttergeist und Erkenntnisgeist, la thèse selon laquelle toute l’histoire de la civilisation représente une perversion, car elle se définit par la révolte de l’homme contre la prééminence naturelle que, selon cet auteur, la femme devrait avoir sur lui », cela faisait huit ans qu’il « avait commencé à abandonner ses idées matriarcales non pas, selon toute probabilité, parce qu’il avait changé d’avis, mais plutôt parce qu’il s’était rendu compte que ses théories n’étaient pas bien accueillies par les responsables du parti nazi » (Peter Davies, op. cit., p. 204).
(62) Julius Evola, Il Cammino…, p. 160.
(63) Ernest Seillière, Houston-Stewart Chamberlain, le plus récent philosophe du pangermanisme mystique, Paris, La Renaissance du Livre, 1917.
